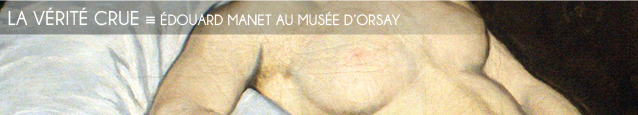ILS ONT FAIT de la recherche de la beauté et de la perfection plastique le sens de leur oeuvre ; oubliant morale et religion, ils ont savouré l'art dans ce qu'il offrait de plus sensuel et de plus voluptueux. Aujourd'hui, les esthètes anglo-saxons de la seconde moitié du XIXe siècle s'exposent au Musée d'Orsay, sous la plume toujours acérée du dandy Oscar Wilde, dont les aphorismes ponctuent la visite et éclairent les enjeux de l'Æsthetic Movement.
–
Par Grégory Le Floc'h
TOUT EST CALME dans le jardin. Au loin, un port tranquille, immobile, silencieux. La nature retient son souffle pour ne pas troubler le sommeil de celle qui s'est endormie dans sa longue robe blanche. Gardiens de la quiétude de cet écrin vert, deux anges agenouillés dans l'herbe, de chaque côté d'un harmonium, caressent une vielle et un violon. Un manuscrit médiéval posé sur les genoux, les mains délicatement jointes sur une rose, l'oreille de la jeune femme assoupie dans un luxueux fauteuil est bercée par le clapotis suave d'une fontaine à l'ombre d’un rosier. Coquelicots et pavots, flattés par cette musique céleste, illuminent le jardin de pourpre et de mauve. Dans ce sommeil paradisiaque que peint J.W. Waterhouse (Saint Cecilia, 1895), il y a tout l'Æsthetic Movement qui s'est développé au coeur du XIXe siècle en Angleterre. Inutile de rechercher une morale, un sens ou une histoire dans le tableau. Désormais, seul le plaisir - esthétique, visuel, sensuel - importe.
–
L'art inutile
C'EST EN S'AFFRANCHISSANT des carcans  moraux et religieux du néoclacissime que les tenants de l'Esthétisme partent en quête d'une nouvelle beauté qu'ils veulent tour à tour voluptueuse, sensuelle, pleine de grâce et de poésie. Ils convoquent tous les sens et travaillent à élaborer des symphonies de synesthésie. La musique se lie ainsi à la peinture pour rendre plus grand le délice du spectateur. Inspirés souvent par des poèmes, les artistes de l'époque, à l'instar de James McNeil Whistler, Dante Gabriel Rossetti ou encore Edward Burne-Jones, sont en quête d'une esthétique idéalisée et nouvelle. Les canons de beauté victoriens sont alors déclassés au profit de modèles sensuels et langoureusement féminins.
moraux et religieux du néoclacissime que les tenants de l'Esthétisme partent en quête d'une nouvelle beauté qu'ils veulent tour à tour voluptueuse, sensuelle, pleine de grâce et de poésie. Ils convoquent tous les sens et travaillent à élaborer des symphonies de synesthésie. La musique se lie ainsi à la peinture pour rendre plus grand le délice du spectateur. Inspirés souvent par des poèmes, les artistes de l'époque, à l'instar de James McNeil Whistler, Dante Gabriel Rossetti ou encore Edward Burne-Jones, sont en quête d'une esthétique idéalisée et nouvelle. Les canons de beauté victoriens sont alors déclassés au profit de modèles sensuels et langoureusement féminins.
UNE TELLE RÉVOLUTION dans le monde de l'art ne s'opère pourtant pas sans controverses. Celle que ses détracteurs appellent "l'Ecole de la sensualité" est notamment attaquée pour son caractère scabreux. Refusant toute subordination sociale ou religieuse, l'Esthétisme promeut "l'art pour l'art" et développe l'idée de l'inutilité de la création artistique. "Nous pouvons pardonner à celui qui fabrique un objet utile, pourvu qu’il ne l'admire pas, écrit Wilde. La seule excuse valable, quand on crée un objet inutile, c'est de l'admirer intensément. L'art tout entier est parfaitement inutile." Si les sujets bibliques sont exploités, c'est pour mieux les vider de leur contenu moral et ne plus privilégier que la recherche formelle. Car les esthètes n'ont cure de la vérité historique ou du sens. Ils oeuvrent à une symbiose des arts qui irait du Japon à l'antiquité gréco-latine en passant par l'époque médiévale, associant allègrement des époques, des cultures et des lieux a priori antinomiques en un même espace et un même lieu. Il en va ainsi d'Azaleas d'Albert Moore (1867), dans lequel une femme vêtue d'une draperie de style préraphaélite cueille des fleurs d'azalées dans une céramique japonaise. L'exotisme de la scène grecque se conjugue à la beauté insolite de l'artisanat nippon ; le ravissement des sens l'emporte sur tout le reste, comme le résume le critique Algernon Swinburne : "Le sens de la toile est la beauté et sa raison d'être est d'être."
–
L'art contre la vie
DE FAIT, L'ARCHIPEL ASIATIQUE fascine les esthètes. L'Europe est envahie d'objets de décoration japonais suite à la convention de Kanagawa de 1854 qui a permis l'ouverture commerciale du Japon. Les artistes explorent avec minutie et passion cette nouvelle culture, y percevant la possibilité d'une révolution esthétique. Oscar Wilde, lors d'une conférence aux Etats-Unis, confie ainsi qu'il craint qu'on ait  entendu parler de lui "comme d'un jeune homme pour qui la pire difficulté qui fût était de mener une existence digne de sa porcelaine bleue". Symbole de raffinement extrême et d'exotisme, les vases japonais saturent bientôt les toiles, comme dans Symphonie en blanc, n°2 de McNeil Whistler (1864) - grand collectionneur d'estampes et de céramiques -, où la robe blanche du modèle rivalise d'éclat avec un vase posé sur la cheminée.
entendu parler de lui "comme d'un jeune homme pour qui la pire difficulté qui fût était de mener une existence digne de sa porcelaine bleue". Symbole de raffinement extrême et d'exotisme, les vases japonais saturent bientôt les toiles, comme dans Symphonie en blanc, n°2 de McNeil Whistler (1864) - grand collectionneur d'estampes et de céramiques -, où la robe blanche du modèle rivalise d'éclat avec un vase posé sur la cheminée.
VOYAGE DANS L'ESPACE, mais aussi voyage dans le temps : les yeux des créateurs se portent tout autant vers l'Antiquité gréco-latine. Plusieurs joailliers s'inspirent de bijoux de l'époque, comme Laurence Alma-Tadema qui reproduit un bracelet manchette sous la forme d'un serpent d'or s'enroulant en spirale autour de l'avant-bras. Les drapés des vêtements grecs deviennent aussi une référence incontournable : Georges Frederic Watts, Whistler, Edward Burne-Jones et William Morris ne se lassent pas de peindre leurs héroïnes dans des vêtements antiquisants. Le caractère lascif des personnages d'Albert Moore dans A Musician (1865) n'est pas sans rappeler une peinture murale d’Herculanum. Mais le jeu sur la composition et les attitudes des sujets, plus qu'à un jeu d'échos avec l'histoire de l'art, ne vise que l'émotion. "A une époque où la laideur et la raison prévalent, les arts empruntent non pas à la vie, mais aux autres arts", poursuit Oscar Wilde. Si l'univers que l'Esthétisme construit semble si parfait, c'est bien le résultat de son détachement de toute référentialité autre qu'artistique. Poésie, peinture et sculpture s'inspirent mutuellement sans jamais affronter le monde réel. Si bien que le principe de "l'art pour l'art" libère l'univers mental des artistes, qui ne se soucient plus ni de cohérence ni de rationalité. Voici un monde idéal et exquis, si proche de la perfection esthétique qu'il se vide de toute humanité.
–
L'art dans la vie
EN NE SE LIMITANT PAS aux beaux-arts, la recherche de la beauté envahit le quotidien. C'est ainsi que Burne-Jones, Morris et Rossetti vont, à l'encontre des conventions de l'intérieur domestique anglais, faire de chaque pièce de mobilier une création unique, support d'une expression artistique entièrement dévouée à la profusion de la beauté dans la vie de tous les jours.  Fauteuils, armoires, faïences, ferronnerie, broderies, vitraux, papiers peints... L'intérieur devient un décor de théâtre, où là encore la pièce se joue entre le Moyen-âge, l'Antiquité et l'art japonais, jusqu'à l'excentricité fantasque. Des motifs d'inspiration nippone, comme la plume de paon ou le papillon, s'infiltrent dans tous les intérieurs coquets d'un cercle de riches intellectuels anglais sans lesquels l'Æsthetic Movement n'aurait sans doute pas connu le même retentissement.
Fauteuils, armoires, faïences, ferronnerie, broderies, vitraux, papiers peints... L'intérieur devient un décor de théâtre, où là encore la pièce se joue entre le Moyen-âge, l'Antiquité et l'art japonais, jusqu'à l'excentricité fantasque. Des motifs d'inspiration nippone, comme la plume de paon ou le papillon, s'infiltrent dans tous les intérieurs coquets d'un cercle de riches intellectuels anglais sans lesquels l'Æsthetic Movement n'aurait sans doute pas connu le même retentissement.
C'EST SURTOUT AUX FEMMES que l'on doit cette épiphanie esthétique de la vie quotidienne, elles qui promeuvent un "mode de vie" qui va bien au-delà de la création artistique. Fascinées par la perfection des vêtements d'inspiration antique mis en scène par leurs peintres favoris, elles abandonnent bientôt le corset victorien pour des drapés immaculés qui libèrent leur silhouette. Tout se passe comme si la réalité devait devenir une œuvre d'art à part entière. Elles se ruent bientôt dans les ateliers pour se faire peindre en héroïnes préraphaélites, comme en témoigne ce portrait de la comtesse Brownlow, mécène du mouvement, qui pose pour Frederic Leighton dans une robe de soie claire aux plis tourbillonnants. Le va-et-vient entre l'art et la vie fait tourner la tête.
RIEN D'ÉTONNANT, dans ce contexte, à ce que l'activité artisanale s'emballe. D'autant plus que les artisans ne travaillent pas que pour l'élite britannique, mais s'affairent également à transformer les meubles de la classe moyenne. L'Esthétisme, clamant toujours l'inutilité de la création et affirmant son absence d'ancrage dans le réel, devient paradoxalement politique en prônant l'art pour tous. Lambris, bibelots, mais aussi meubles et papiers peints - qui façonnent de véritables paysages dans les maisons : tout est bon pour parfumer les intérieurs anglais d'une atmosphère atemporelle, emportant tout le monde vers un ailleurs imaginaire qui irradie jusqu'à l'aveuglement. Chaque moment de la journée devient bientôt l'occasion d'une nouvelle affirmation esthétique, comme l'heure du thé qui, sous la main  de Christopher Dresser, fleure bon le japon avec sa théière assemblée de formes géométriques. Une quête absolue de la beauté dans chaque geste et chaque détail qui, à bout de souffle, s'ouvre et fâne, comme une rose, au crépuscule du XIXe siècle dans le mouvement décadent. Ennivré, Oscar Wilde prédit alors que "l'avenir appartient aux dandys" et que "le règne des précieux est imminent." Il ne sait pas qu'il est déjà trop tard.
de Christopher Dresser, fleure bon le japon avec sa théière assemblée de formes géométriques. Une quête absolue de la beauté dans chaque geste et chaque détail qui, à bout de souffle, s'ouvre et fâne, comme une rose, au crépuscule du XIXe siècle dans le mouvement décadent. Ennivré, Oscar Wilde prédit alors que "l'avenir appartient aux dandys" et que "le règne des précieux est imminent." Il ne sait pas qu'il est déjà trop tard.
G. Le F.
--------------------------
à Paris, le 20/12/2011
Beauté, morale et volupté dans l’Angleterre d’Oscar Wilde
Jusqu'au 15 janvier 2012
Musée d’Orsay
1 rue de la Légion d'Honneur
75007 Paris
Tlj (sf lun) 9h30-18h
Nocturne jeu (21h45)
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5,5 €
Rens : 01 40 49 48 14

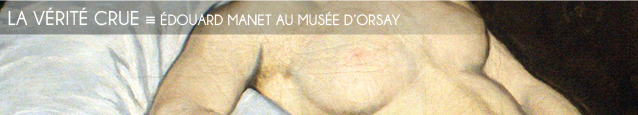
 Crédits et légendes images
Crédits et légendes images
Vignette sur la page d'accueil : Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) La Roue de la Fortune, entre 1875 et 1883 Huile sur toile, 216 x 154 cm Paris, musée d'Orsay © RMN (Musée d'Orsay) / Gérard Blot
Image 1 Frederic Leighton (1830-1896) Pavonia, 1858-1859 Huile sur toile, 53 x 41,5 cm Londres, collection particulière, c/o Christie's © Christie's Images
Image 2 Sir Edward Burne-Jones (1833-1898) La Roue de la Fortune, entre 1875 et 1883 Huile sur toile, 216 x 154 cm Paris, musée d'Orsay © RMN (Musée d'Orsay) / Gérard Blot
Image 3 Christophe Dresser (1834-1904) Soupière, vers 1888 Manufacture Hukin & Heath, Birmingham Métal, argent, ébène Paris, musée d'Orsay © Musée d'Orsay, dist. RMN / Patrice Schmidt
Image 4 Julia Margaret Cameron (1815-1879) À la manière des frises du Parthénon – (After the Manner of the Elgin Marbles), 1867 Épreuve sur papier albuminé à partir d'un négatif verre au collodion humide, 67 x 57 cm Londres, Victoria and Albert Museum, legs Nevison © V&A Images

 moraux et religieux du néoclacissime que les tenants de l'Esthétisme partent en quête d'une nouvelle beauté qu'ils veulent tour à tour voluptueuse, sensuelle, pleine de grâce et de poésie. Ils convoquent tous les sens et travaillent à élaborer des symphonies de synesthésie. La musique se lie ainsi à la peinture pour rendre plus grand le délice du spectateur. Inspirés souvent par des poèmes, les artistes de l'époque, à l'instar de James McNeil Whistler, Dante Gabriel Rossetti ou encore Edward Burne-Jones, sont en quête d'une esthétique idéalisée et nouvelle. Les canons de beauté victoriens sont alors déclassés au profit de modèles sensuels et langoureusement féminins.
moraux et religieux du néoclacissime que les tenants de l'Esthétisme partent en quête d'une nouvelle beauté qu'ils veulent tour à tour voluptueuse, sensuelle, pleine de grâce et de poésie. Ils convoquent tous les sens et travaillent à élaborer des symphonies de synesthésie. La musique se lie ainsi à la peinture pour rendre plus grand le délice du spectateur. Inspirés souvent par des poèmes, les artistes de l'époque, à l'instar de James McNeil Whistler, Dante Gabriel Rossetti ou encore Edward Burne-Jones, sont en quête d'une esthétique idéalisée et nouvelle. Les canons de beauté victoriens sont alors déclassés au profit de modèles sensuels et langoureusement féminins. entendu parler de lui "comme d'un jeune homme pour qui la pire difficulté qui fût était de mener une existence digne de sa porcelaine bleue". Symbole de raffinement extrême et d'exotisme, les vases japonais saturent bientôt les toiles, comme dans Symphonie en blanc, n°2 de McNeil Whistler (1864) - grand collectionneur d'estampes et de céramiques -, où la robe blanche du modèle rivalise d'éclat avec un vase posé sur la cheminée.
entendu parler de lui "comme d'un jeune homme pour qui la pire difficulté qui fût était de mener une existence digne de sa porcelaine bleue". Symbole de raffinement extrême et d'exotisme, les vases japonais saturent bientôt les toiles, comme dans Symphonie en blanc, n°2 de McNeil Whistler (1864) - grand collectionneur d'estampes et de céramiques -, où la robe blanche du modèle rivalise d'éclat avec un vase posé sur la cheminée. Fauteuils, armoires, faïences, ferronnerie, broderies, vitraux, papiers peints... L'intérieur devient un décor de théâtre, où là encore la pièce se joue entre le Moyen-âge, l'Antiquité et l'art japonais, jusqu'à l'excentricité fantasque. Des motifs d'inspiration nippone, comme la plume de paon ou le papillon, s'infiltrent dans tous les intérieurs coquets d'un cercle de riches intellectuels anglais sans lesquels l'Æsthetic Movement n'aurait sans doute pas connu le même retentissement.
Fauteuils, armoires, faïences, ferronnerie, broderies, vitraux, papiers peints... L'intérieur devient un décor de théâtre, où là encore la pièce se joue entre le Moyen-âge, l'Antiquité et l'art japonais, jusqu'à l'excentricité fantasque. Des motifs d'inspiration nippone, comme la plume de paon ou le papillon, s'infiltrent dans tous les intérieurs coquets d'un cercle de riches intellectuels anglais sans lesquels l'Æsthetic Movement n'aurait sans doute pas connu le même retentissement. de Christopher Dresser, fleure bon le japon avec sa théière assemblée de formes géométriques. Une quête absolue de la beauté dans chaque geste et chaque détail qui, à bout de souffle, s'ouvre et fâne, comme une rose, au crépuscule du XIXe siècle dans le mouvement décadent. Ennivré, Oscar Wilde prédit alors que "l'avenir appartient aux dandys" et que "le règne des précieux est imminent." Il ne sait pas qu'il est déjà trop tard.
de Christopher Dresser, fleure bon le japon avec sa théière assemblée de formes géométriques. Une quête absolue de la beauté dans chaque geste et chaque détail qui, à bout de souffle, s'ouvre et fâne, comme une rose, au crépuscule du XIXe siècle dans le mouvement décadent. Ennivré, Oscar Wilde prédit alors que "l'avenir appartient aux dandys" et que "le règne des précieux est imminent." Il ne sait pas qu'il est déjà trop tard.