 Jean Genet : "Ma solitude connaît la vôtre"
Jean Genet : "Ma solitude connaît la vôtre"
"Je vous rappelle que je n'ai ni père ni mère,
Que j'ai été élevé par l'assistance publique
Que j'ai su très jeune que je n'étais pas Français,
Que je n'appartenais pas au village.
Je ne connais pas ma famille…"
Un an après avoir célébré le centenaire de la naissance de l'écrivain, ces quelques vers de Jean Genet, parus dans Die Zeit le 13 février 1976, sont le point de départ de l'exposition Genet, ni père ni mère organisée par Michel Chomarat à la Bibliothèque municipale de Lyon. Cette ville qui est au coeur du cheminement de l'auteur de Querelle de Brest (1947), tant parce qu'elle est celle de sa mère que de ses collaborations successives avec Marc Barbezat. L'occasion de revenir sur l'abandon et la quête d'identité d’un homme qui a cherché, sa vie durant, à se doter d'une filiation, même mythique.
La question de la famille chez Jean Genet (1910-1986) peut paraître contradictoire : son statut d'enfant abandonné, bien souvent commenté, annonce l'absence de tout père ou de toute mère dans son oeuvre, son peu d'attachement à la patrie, ou encore l'utilisation de la langue maternelle comme langue de l'ennemi. Fils de personne, Genet ne sera père d'aucun. Mais il sera perpétuellement en recherche d'une famille, et la trouvera peu à peu, au gré de ses pérégrinations, avec des compagnons de fortune ou d'infortune, rencontrés lors de ses incarcérations ou de ses itinérances. Héritage familial par excellence, la question du nom est centrale pour comprendre Jean Genet. Il tient le sien du côté maternel : né de père inconnu - ce n'est que bien plus tard, lors de l'ouverture du dossier à l'Assistance Publique, que l'on apprend qu'il se nomme Frédéric Blanc -, il est laissé par sa mère, Camille Gabrielle Genet, à Paris le 19 décembre 1910, à l'âge de sept mois. Cet abandon nourrira l'ensemble de son travail, de Notre-Dame-des-Fleurs (1944) à Un captif amoureux (1986), car la figure de la mère y est, de façon assez paradoxale, centrale : elle est omniprésente par son absence, son ombre rôde dans chacun de ces livres. Ce nom, cet unique patrimoine, est le seul écho qu'elle laisse. La revendication du patronyme est dès lors essentielle pour celui qui n'a pas de racine : c'est grâce à lui que Jean Genet s'affirme comme individu, effaçant ainsi le matricule 192.102 que lui a attribué l'Etat.
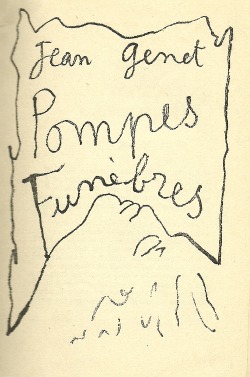 Pour vaincre ce vide et cette absence, il s'invente une généalogie légendaire et crée un mythe autour de son ascendance. Il commence par mettre en avant son origine florale, allant jusqu'à ajouter l'accent circonflexe qui manque à son nom sur certaines publications : "Je fus élevé dans le Morvan par des paysans, écrit-il dans Le Journal du voleur (1949). Quand je rencontre dans la lande - et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais - des fleurs de genêt, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi - peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage hommage, s'inclinent sans s'incliner mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais."
Pour vaincre ce vide et cette absence, il s'invente une généalogie légendaire et crée un mythe autour de son ascendance. Il commence par mettre en avant son origine florale, allant jusqu'à ajouter l'accent circonflexe qui manque à son nom sur certaines publications : "Je fus élevé dans le Morvan par des paysans, écrit-il dans Le Journal du voleur (1949). Quand je rencontre dans la lande - et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais - des fleurs de genêt, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi - peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage hommage, s'inclinent sans s'incliner mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines, par elles, dans ce sol de France nourri des os en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés par Gilles de Rais."
Ce n'est pas un hasard si les genêts dont parle l'écrivain, placé dans une famille d'accueil dans le Morvan, se situent à proximité du château du comte de Rais, celui-là même qui a inspiré la légende de Barbe-Bleue. Car c'est de ses racines végétales qu'il tire son origine de damné : il se convainc d'être la réincarnation des enfants torturés et se donne ainsi un ancêtre mythique, le serviteur de Jeanne d'Arc. Mais ce nom possède aussi une autre connotation : il évoque l'histoire royale, comme le souligne un autre épisode de son Journal du voleur. Incarcéré à Fontevrault, il doit décliner son identité : "Ton nom - Genet. - PlantaGenet ? - Genet je vous dis. - Et si je veux dire PlantaGenet, moi ? Ca te dérange ?" C'est autour de ces deux axes que se constitue le mythe Genet. Dès lors, l'auteur se dote d'une identité, même fictive. Il peut se mettre en quête d'une famille. Assez étonnament, c'est la colonie pénitentiaire agricole de Mettray qui tient lieu, pour lui, de figure maternelle et protectrice. Organisée autour de quelques aînés, la "maison" applique une discipline qui, à ses yeux, possède un charme féodal cadrant parfaitement avec son ascendance fictive. Plus tard, la prison lui apparaît encore comme un lieu maternel, où il est sûr de recevoir le gîte et le couvert.
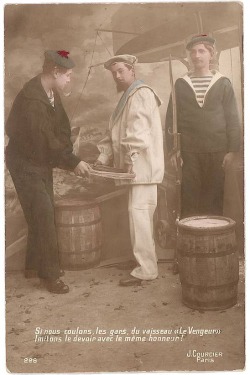 Après plusieurs incarcérations - essentiellement pour vols -, il risque, au début des années 1940, la perpétuité ou la relégation - l'exil définitif aux colonies. Son Condamné à mort (1948), écrit en prison, circule clandestinement et devient son sauf-conduit. Grâce à la réputation qu'il lui confère, trois hommes font pression sur le préfet et obtiennent sa libération : Marc Barbezat, directeur de la revue littéraire lyonnaise L'Arbalète fondée en 1940, l'écrivain Jean Cocteau et Henri Mondor, professeur de médecine et biographe de Mallarmé. Tous trois vont devenir capitaux dans la vie professionnelle et affective de Jean Genet, comme l'atteste en particulier la correspondance de l'écrivain avec Marc Barbezat et sa femme, Olga. A trente-quatre ans, Genet renoue avec la ville natale de sa mère et revient à Lyon pour travailler avec le directeur de L'Arbalète. Malgré des profils tout à fait différents - Barbezat est pharmacien, fils d'un riche industriel et protestant - , la confiance s'instaure entre les deux hommes. La revue compte treize numéros jusqu'en 1948, et publie aussi bien Artaud que Mouloudji, Sartre, Hemingway ou encore Queneau. Dès 1941, la revue fait aussi office de maison d'édition, et Barbezat décide, le premier, de publier les oeuvres de l'écrivain subversif, parmi lesquelles Notre-Dame-des-Fleurs, Miracle de la Rose ou encore L'Enfant Criminel. Mais en 1966, suite à une brouille, Jean Genet se sépare de Barbezat et rejoint les éditions Gallimard.
Après plusieurs incarcérations - essentiellement pour vols -, il risque, au début des années 1940, la perpétuité ou la relégation - l'exil définitif aux colonies. Son Condamné à mort (1948), écrit en prison, circule clandestinement et devient son sauf-conduit. Grâce à la réputation qu'il lui confère, trois hommes font pression sur le préfet et obtiennent sa libération : Marc Barbezat, directeur de la revue littéraire lyonnaise L'Arbalète fondée en 1940, l'écrivain Jean Cocteau et Henri Mondor, professeur de médecine et biographe de Mallarmé. Tous trois vont devenir capitaux dans la vie professionnelle et affective de Jean Genet, comme l'atteste en particulier la correspondance de l'écrivain avec Marc Barbezat et sa femme, Olga. A trente-quatre ans, Genet renoue avec la ville natale de sa mère et revient à Lyon pour travailler avec le directeur de L'Arbalète. Malgré des profils tout à fait différents - Barbezat est pharmacien, fils d'un riche industriel et protestant - , la confiance s'instaure entre les deux hommes. La revue compte treize numéros jusqu'en 1948, et publie aussi bien Artaud que Mouloudji, Sartre, Hemingway ou encore Queneau. Dès 1941, la revue fait aussi office de maison d'édition, et Barbezat décide, le premier, de publier les oeuvres de l'écrivain subversif, parmi lesquelles Notre-Dame-des-Fleurs, Miracle de la Rose ou encore L'Enfant Criminel. Mais en 1966, suite à une brouille, Jean Genet se sépare de Barbezat et rejoint les éditions Gallimard.
Le sort semble s'acharner sur l'orphelin perpétuel : dès son plus jeune âge, en 1922, la perte d'Eugénie, la mère de sa famille d'accueil, est vécue comme un second abandon. Et à plusieurs reprises, la mort fauche ses amants : l'origine de Pompes funèbres (1948) est le décès, en 1944, de Jean Decarnin, un jeune résistant tué les armes à la main que Genet a aimé. Vingt ans plus tard, c'est Abdallah, un jeune accrobate qu'il considérait peut-être comme l'amour de sa vie et pour qui il avait écrit Le Funambule (1958), qui se suicide après un accident l'ayant lourdement handicapé. A la fin de sa vie, il connaît une nouvelle relation impossible : en 1974, il rencontre au Maroc Mohammed El-Katrani qu'il va pourtant encourager à se marier. A cette époque, le projet qui l'occupe, en dehors de la rédaction du Captif amoureux, est le "projet Azzédine". Azzédine est le fils de Mohammed et Genet vit avec lui une relation fusionnelle, à plus de 70 ans. Ce n'est peut-être qu'à ce moment qu'il parvient enfin à construire une relation fondée sur un amour sans condition : "Le bonheur de cet événement, sa simplicité me bouleversèrent. […] Je me dispersais à tous les points du monde et j’enregistrais cent détails qui éclataient en étoiles légères."
Christel Brun-Franc, à Lyon
Le 07/05/11

Jean Genet ni père ni mère, jusqu'au 28 mai 2011
Bibliothèque Municipale de Lyon
30 boulevard Vivier-Merle
69000 Lyon
Mar-vend. : 10h-19h
Sam : 10h-18h
Entrée libre
Rens. : 04 78 62 18 00
D'autres articles de la Rubrique Pages