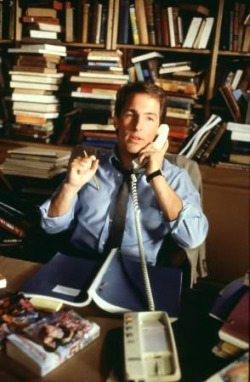 Compte rendu de journée d'études
Compte rendu de journée d'études
HBO : séries d'élite, culture populaire
Six Feet Under, Les Soprano, Oz, Sex & The City... Les productions de la chaîne câblée américaine HBO, multipliant les innovations esthétiques et narratives, l'ont auréolée de prestige. Début juin, une journée d'études lui a été consacrée, organisée par le groupe HPCP (Histoire et Pratiques de la Culture Populaire) avec le Centre d'Histoire de Sciences Po Paris et l'Université de Picardie-Jules Verne. La veille, Gary Edgerton, professeur à la Old Dominion University (Norfolk, Virginie) et auteur du récent Essential HBO Reader (2008), était invité à définir la spécificité de la chaîne dans le paysage audiovisuel américain autour d'une table ronde. A sa suite, plusieurs chercheurs ont interrogé le rôle esthétique et culturel de la chaîne et la spécificité de sa production depuis le début des années 1990, en traitant au cas par cas certaines séries emblématiques de HBO.
Comment une chaîne télévisée a-t-elle su imposer une identité visuelle et scénaristique aussi forte, au point de faire passer nombre de ses productions pour le petit écran pour de véritables chefs-d'oeuvre dignes du grand ? Pour raconter cette révolution, Gary Edgerton a commencé par présenter la chronologie élaborée dans son ouvrage
History of American Television (2007), distinguant quatre grandes périodes dans l'histoire de la télévision américaine. Expérimentale jusqu'en 1948, celle-ci a peu à peu fédéré ses publics, s'imposant comme un media de masse. Mais, à la fin des années 1970, plusieurs alternatives aux chaînes hertziennes bousculent les habitudes des spectateurs, notamment la démocratisation progressive du magnétoscope et le développement du câble. Dans un même mouvement, les chaînes se spécialisent. Après 1996, la télévision et les nouveaux média se rapprochent, au sein de ce qu'il est aujourd'hui courant d'appeler la "révolution numérique", permettant la diffusion de contenus plus pointus et ciblés. En effet, la multiplication des supports (DVD, Internet, etc.) et l'éclatement des goûts et des attentes du public américain débouchent sur des cultures de niche. Dans ce contexte, la chaîne HBO, avec son slogan scandé depuis 1997 : "
Ce n'est pas de la télé, c'est HBO", va faire figure de modèle et de repère constant. Diffusée depuis 1972, la chaîne repose dès son origine sur un accès par abonnement, bénéficiant ainsi d'une absence de coupures publicitaires durant les programmes. Son identité, d'abord ancrée dans la retransmission d'événements, notamment sportifs, va rapidement se rapprocher de sa spécificité actuelle par la diffusion, avant les chaînes hertziennes, de films contemporains. Son succès grandit jusque dans les années 1990, où une stagnation de son nombre d'abonnés pousse les dirigeants de la chaîne à se réinventer. Et à créer du contenu propre.
Les séries HBO, plus chères que celle des grands networks (CW, Fox, ABC...), tranchent par la durée de leurs saisons (courte) et l'écriture scénaristique (soignée). Une grande liberté caractérise ces nouvelles fictions en plusieurs épisodes, qui font fi de la censure du FCC grâce au statut privé de la chaîne. Au fil de la journée d'études organisée par le groupe HPCP, la plupart des séries marquantes de la chaîne ont été étudiées, malgré l'absence notable de
Curb Your Enthusiasm - dont la dizième saison est en cours de production, ce qui constitue un record de longévité pour une série HBO - ou de
Sex and the City, pourtant l'un des plus grands succès d'audience de HBO. Son ancêtre, en termes de liberté dans la représentation des mœurs sexuelles,
Dream On, permet en début de journée d'ancrer le succès de la chaîne dans une stratégie de rupture, dès les années 1990, confirmée par

l'apparition de la série carcérale et ultra-violente
Oz en 1997. Le propos de la journée d'études s'est toutefois davantage porté sur les années 2000, en particulier dans la seconde partie de la journée, interrogeant les stratégies de production et les grandes figures qui les ont mises en place comme Alan Ball, Tom Fontana ou David Simon. L'image de la chaîne a été le fil d'ariane des communications qui se sont succédé et qui ont autant cherché à analyser le mythe de la "qualité HBO" et l'apport concret de celle-ci à la culture audiovisuelle, qu'à réfléchir sur un "âge d'or" peut-être aujourd’hui révolu. En effet, alors que les années 1990-2000 ont été très fastes, HBO pourrait bien entonner son chant du cygne : récemment, ses audiences ont chuté, tandis que d’autres chaînes la concurrencent sur son propre terrain, à l'instar de la série AMC
Mad Men (2007) qui, en trois saisons, s'est imposée comme la digne héritière des
Soprano.
Au coeur de la journée : montrer en quoi les séries HBO proposent une certaine analyse de la société américaine en prise avec le monde contemporain. Ainsi,
Dream On, abordée par Marc Cerisuelo, philosophe et directeur de la résidence Lucien Paye, et Vincent Colonna, écrivain, incarne dans les années 1990 une rupture avec le modèle traditionnel d'une certaine sitcom familiale où les personnages évoluent dans une "bulle", coupés des enjeux sociaux, politiques et culturels, comme le
Cosby Show (1984) ou
Quoi de neuf Docteur ? (1985). La série se démarque dès lors par sa liberté de ton et son ancrage social, mais aussi par son hybridité formelle, intégrant notamment des images d'archives des feuilletons en noir et blanc des années 1930-40, à la manière des catalogue pictures (1) qui permettaient aux studios hollywoodiens de recycler leurs productions. C'est toute une "
historicité du déjà-dit" qui devient ici un principe de narration et de mise à distance. Les intrigues de
Dream On sont multiples, parfois complexes et le plus souvent réflexives : déjà utilisés par
Clair de Lune, une série ABC diffusée à partir de 1985, les regards caméra, les adresses au public et l'usage de voix off vont devenir des leitmotivs de la série télévisée. Dans le débat qui a suivi la communication,
Les Simpsons (une production Fox) et
How I Met Your Mother (CBS) sont apparues respectivement comme fondatrice et comme figure du renouvellement de cette tendance de la sitcom réflexive.
Oz est elle aussi présentée dans la section "classiques", cette fois par Sèverine Barthes, docteur en histoire des médias. En huit saisons, la série créée par Tom Fontana décrit le quotidien de prisonniers incarcérés dans une prison expérimentale inspirée par le modèle du panopticon de Jeremy Bentham et explore tout particulièrement la question de la voix off et le problème des idéologies à travers la figure d'Augustus Hill. Ce dernier, prisonnier appartenant au récit, s'en extraie pourtant régulièrement pour rejoindre "le cube" où il élabore un commentaire sur l'action en cours ou sur un thème particulier. La question de l’éducation en prison, du fichage des délinquants sexuels et bien d’autres problèmes de société sont ainsi abordés dans la série. Si son créateur refuse l'étiquette

d'oeuvre à message pour la série, celle-ci reste empreinte de discours idéologique. De façon parfois indirecte, aussi, par un jeu savant de références culturelles : Augustus Hill a ainsi des allures de chœur de tragédie grecque, et certaines images ne sont pas sans rappeler la Cène, parmi d'autres épisodes bibliques.
La société américaine est également disséquée dans
The Wire, comme le montre Sandra Laugier, Professeur de philosophie à l'Université de Picardie-Jules Verne. Sa structure en cinq saisons permet à la série créée par David Simon de se focaliser successivement sur différents contextes sociaux et politiques : la police, les syndicats, les hommes politiques, les professeurs, et enfin les journalistes. Au centre de ces différents milieux, un même contexte : le commerce de la drogue à Baltimore et les écoutes destinées à démanteler les réseaux impliqués.
The Wire n'installe de manichéisme que pour mieux le démonter. La figure du héros est définitivement oubliée au profit de personnages qui compliquent l'identification du spectateur. Cependant la figure du Mal absolu reste un extrême possible, incarnée dans ce cas par le journaliste Scott Templeton, c’est-à-dire celui qui manipule et travestit les faits. Reposant sur une esthétique documentaire,
The Wire révèle plus largement un projet esthético-moral, qui brouille autant les repères moraux qu'il contribue à les resituer.

Poursuivant dans le renversement des valeurs,
True Blood, créée par Alan Ball, explore la possibilité d'un monde où les vampires ne sont plus des monstres, mais une minorité visible, sortie des cercueils pour mener une lutte des droits civiques tardive - la première saison expose par exemple leur tentative d'obtention du droit de vote. En s'opposant à une droite chrétienne virulente, les vampires révèlent leur parfaite maîtrise des média. Bill Maher (2) joue là son propre rôle et anime les débats entre les partis opposés, donnant ainsi l'occasion à
True Blood de questionner non seulement le discours associé aux minorités américaines, mais aussi la mise en scène des conflits sociaux et raciaux par les media. Paola Marrati, professeur à l'Université John Hopkins à Baltimore, discerne dans la série plusieurs enjeux culturels : le rôle des media, la place de l'histoire dans l'identité des individus et des collectivités... Bill Compton est ainsi un vampire qui incarne la difficulté de l'Amérique, et plus particulièrement du Sud, à négocier avec son héritage - notamment le souvenir de la Guerre de Sécession et de la ségrégation. Par ailleurs, Paola Marrati a aussi suggéré l'existence de problématiques plus vastes, telle la question des limites de l'humain. Dans
True Blood, ce n'est pas tant le désir des humains de devenir vampire qui est abordé que la lassitude essentielle des vampires face à leur éternité - et leur possible désir de mort.
La fin des séries elle-même est une perspective d'analyse que Tristan Garcia adopte pour commenter
John from Cincinnati (2007), proposant même un corpus original d'œuvres "maudites", autrement dit de séries inachevées car peu regardées, tout autant fascinantes par leur statut marginal et leur conclusion ouverte. L'absence de fin réelle ou le cliffhanger (3) déçu - par exemple celui ajouté par Daniel Knauf, le créateur de
Carnivàle, pour permettre un éventuel rebond -, ramène à la question de la finitude - qui pointe, menaçante, à travers le discours creux de John Monad. Censée remplacer L
es Soprano,
John from Cincinnati met en scène des personnages réduits à des copies creuses des grandes figures de la série (gangsters, avocats...), revenues

pour un dernier tour de piste autour du fameux John du titre, sorte de messie dont la capacité discursive se résume à répéter les dernières paroles de ses interlocuteurs. Là où
Les Soprano avait l'avantage de la clarté générique,
John from Cincinnati, par son mélange de références littéraires messianiques et new age, notamment au
Wise Blood de Flannery O'Connor, a sans doute dérouté.
Jean Du Verger complète ce paysage des séries marginales de HBO par son analyse de
Carnivàle. Moins sévèrement reçue que
John from Cincinnati, la série mêle selon les dires de ses propres créateurs
Les Raisins de la Colère à
Twin Peaks. La présentation est également l'occasion d'évoquer le rôle des génériques. Celui de
Carnivàle annonce la tension entre rêve et réalité qui structure son récit et installe par ailleurs une filiation claire avec trois autres séries :
Deadwood,
Six Feet Under et
Rome.
Carnivàle fait usage du rêve pour donner les clés de sa narration, un principe que l'on peut retrouver dans d'autres productions de la chaîne (
Six Feet Under et
Les Soprano) avec, là encore, une grande proximité dans le traitement visuel des scènes.
Carnivàle intéresse par son hybridité et son "
intertextualité active". Elle suppose un nouveau type de spectateur que Jean Du Verger, empruntant à Bourdieu avec un peu d'ironie, qualifie "
d'herméneute postmoderne".
Autre point de rencontre de plusieurs séries de la chaîne : le rapport que certaines entretiennent à l'Histoire. Ainsi, Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie en lycée, évoque
Generation Kill: Embedded (2008) et son traitement de l'histoire récente. La série suit en effet les trois premières semaines de l'invasion de l'Irak en 2003, sur un mode hyper-documentaire qui vide le récit des marques traditionnelles du film de guerre - que respectait encore largement
Band of Brothers, diffusé quelques jours avant le 11 septembre 2001. Le suspense est évacué, tandis que l'esthétique générale des sept épisodes de la mini-série se veut la plus réaliste possible - intention confirmée par le casting d'anciens marines dans leurs propres rôles.
Generation Kill: Embedded, comme son titre l'annonce, propose l'immersion du spectateur dans le contexte de la guerre : elle montre cependant moins la guerre elle-même que son observation, tout en menant simultanément une réflexion morale sur la possibilité d'une guerre juste.
 Generation Kill
Generation Kill propose une approche critique de l'intervention américaine en Irak et procède au décorticage rigoureux des arguments de l'administration Bush en faveur de la guerre, notamment la notion de guerre préventive. Thibaut de Saint-Maurice défend ainsi la série comme un possible exemple d'instruction morale à la télévision, par opposition à un contenu qui serait simplement moraliste.
Une vision transversale, rassemblant
Rome,
Deadwood,
John Adams,
Band of Brothers et son héritière récente (
The Pacific) permet enfin à Marjolaine Boutet, historienne, d'évoquer simultanément l'histoire des séries HBO et l'Histoire
dans les séries HBO. Ces productions méritent l'appellation "de prestige" en raison de leurs budgets démesurés pour des productions télévisées ainsi que pour leur filiation avec des productions cinématographiques de genre.
Rome,
Deadwood et
John Adams articulent toutes les trois la notion de pouvoir et sa relation avec la Loi, tandis que les deux séries de guerre, produites par le tandem Steven Spielberg - Tom Hanks, ne présentent pas la même unité dans leurs thèmes et traitements.
The Pacific présente ainsi des soldats ennuyés et fatigués par la guerre, ayant perdu le lien fraternel qui constituait le fil rouge de
Band of Brothers.
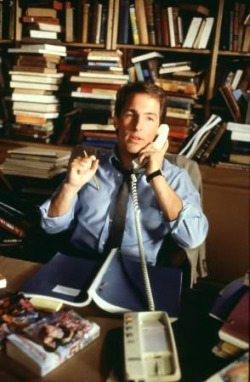 Compte rendu de journée d'études
Compte rendu de journée d'études l'apparition de la série carcérale et ultra-violente Oz en 1997. Le propos de la journée d'études s'est toutefois davantage porté sur les années 2000, en particulier dans la seconde partie de la journée, interrogeant les stratégies de production et les grandes figures qui les ont mises en place comme Alan Ball, Tom Fontana ou David Simon. L'image de la chaîne a été le fil d'ariane des communications qui se sont succédé et qui ont autant cherché à analyser le mythe de la "qualité HBO" et l'apport concret de celle-ci à la culture audiovisuelle, qu'à réfléchir sur un "âge d'or" peut-être aujourd’hui révolu. En effet, alors que les années 1990-2000 ont été très fastes, HBO pourrait bien entonner son chant du cygne : récemment, ses audiences ont chuté, tandis que d’autres chaînes la concurrencent sur son propre terrain, à l'instar de la série AMC Mad Men (2007) qui, en trois saisons, s'est imposée comme la digne héritière des Soprano.
l'apparition de la série carcérale et ultra-violente Oz en 1997. Le propos de la journée d'études s'est toutefois davantage porté sur les années 2000, en particulier dans la seconde partie de la journée, interrogeant les stratégies de production et les grandes figures qui les ont mises en place comme Alan Ball, Tom Fontana ou David Simon. L'image de la chaîne a été le fil d'ariane des communications qui se sont succédé et qui ont autant cherché à analyser le mythe de la "qualité HBO" et l'apport concret de celle-ci à la culture audiovisuelle, qu'à réfléchir sur un "âge d'or" peut-être aujourd’hui révolu. En effet, alors que les années 1990-2000 ont été très fastes, HBO pourrait bien entonner son chant du cygne : récemment, ses audiences ont chuté, tandis que d’autres chaînes la concurrencent sur son propre terrain, à l'instar de la série AMC Mad Men (2007) qui, en trois saisons, s'est imposée comme la digne héritière des Soprano. d'oeuvre à message pour la série, celle-ci reste empreinte de discours idéologique. De façon parfois indirecte, aussi, par un jeu savant de références culturelles : Augustus Hill a ainsi des allures de chœur de tragédie grecque, et certaines images ne sont pas sans rappeler la Cène, parmi d'autres épisodes bibliques.
d'oeuvre à message pour la série, celle-ci reste empreinte de discours idéologique. De façon parfois indirecte, aussi, par un jeu savant de références culturelles : Augustus Hill a ainsi des allures de chœur de tragédie grecque, et certaines images ne sont pas sans rappeler la Cène, parmi d'autres épisodes bibliques.
 pour un dernier tour de piste autour du fameux John du titre, sorte de messie dont la capacité discursive se résume à répéter les dernières paroles de ses interlocuteurs. Là où Les Soprano avait l'avantage de la clarté générique, John from Cincinnati, par son mélange de références littéraires messianiques et new age, notamment au Wise Blood de Flannery O'Connor, a sans doute dérouté.
pour un dernier tour de piste autour du fameux John du titre, sorte de messie dont la capacité discursive se résume à répéter les dernières paroles de ses interlocuteurs. Là où Les Soprano avait l'avantage de la clarté générique, John from Cincinnati, par son mélange de références littéraires messianiques et new age, notamment au Wise Blood de Flannery O'Connor, a sans doute dérouté.  Generation Kill propose une approche critique de l'intervention américaine en Irak et procède au décorticage rigoureux des arguments de l'administration Bush en faveur de la guerre, notamment la notion de guerre préventive. Thibaut de Saint-Maurice défend ainsi la série comme un possible exemple d'instruction morale à la télévision, par opposition à un contenu qui serait simplement moraliste.
Generation Kill propose une approche critique de l'intervention américaine en Irak et procède au décorticage rigoureux des arguments de l'administration Bush en faveur de la guerre, notamment la notion de guerre préventive. Thibaut de Saint-Maurice défend ainsi la série comme un possible exemple d'instruction morale à la télévision, par opposition à un contenu qui serait simplement moraliste. 