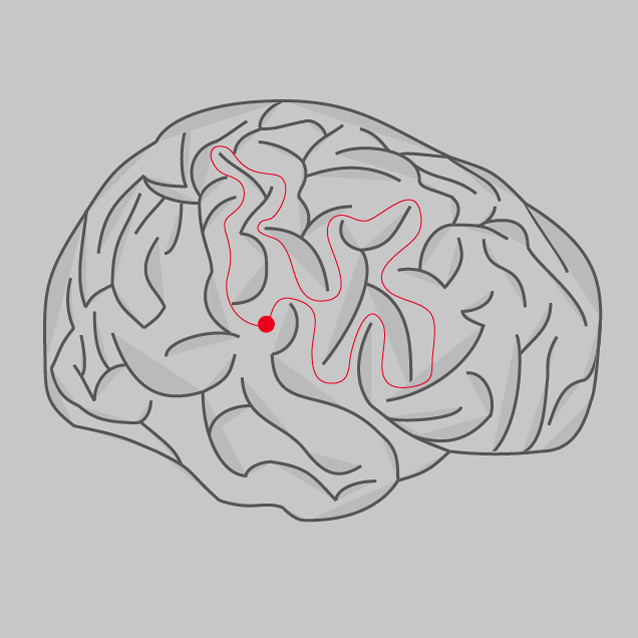PENDANT PLUSIEURS MOIS, Emmanuel Finkiel a filmé la lente rééducation de trois patients qui, à la suite d'un AVC ou d'un grave traumatisme crânien, ont perdu l'usage de certaines fonctions cérébrales. Entre espoir et découragement, le spectateur suit le parcours de ces individus qui se cognent à des murs, serpentent des chemins tortueux, cherchant celui qui les ramènera chez eux à la fois physiquement, dans leur foyer, et symboliquement, dans leur esprit et dans leur corps.
PENDANT PLUSIEURS MOIS, Emmanuel Finkiel a filmé la lente rééducation de trois patients qui, à la suite d'un AVC ou d'un grave traumatisme crânien, ont perdu l'usage de certaines fonctions cérébrales. Entre espoir et découragement, le spectateur suit le parcours de ces individus qui se cognent à des murs, serpentent des chemins tortueux, cherchant celui qui les ramènera chez eux à la fois physiquement, dans leur foyer, et symboliquement, dans leur esprit et dans leur corps.–
Par Fleur Kuhn 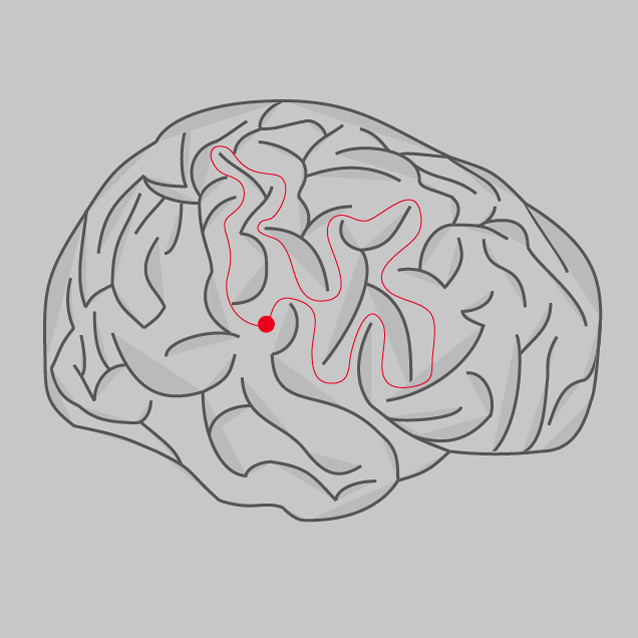
IL Y A D'ABORD cet homme au visage impassible, butant sur les questions que lui pose son interlocutrice : "Comment vous appelez-vous ? Où êtes-vous né ? Votre date de naissance ? Où sommes-nous ? Quel jour sommes-nous ?" Il peine à répondre, inverse les noms de lieux et de métiers, confond les dates. L'orthophoniste, syllabe après syllabe, l'aide à retrouver les mots qui le relient à lui-même. Nous sommes à Coubert, le jeudi 13 novembre 2008. L'homme, né à Longjumeau le 16 juin 1972, s'appelle Christophe Favard.
–
Carapace
CHRISTOPHE FAVARD, au sourire autrefois radieux, est devenu incapable de réagir émotionnellement à ce qu'il vit. Chantal Jamon, atteinte d'aphasie, éprouve de la difficulté à s'exprimer aussi bien qu'à comprendre ce qu'on lui dit, comme si les mots, en elle, s’étaient décrochés de la réalité. Christophe Gruaz, resté plus de deux mois dans un coma dont on croyait qu'il ne se réveillerait jamais, a finalement repris conscience, mais ne parle depuis qu'avec difficulté. Il a perdu l'usage de ses jambes et reste paralysé en plusieurs endroits de son corps.
À MESURE QUE DÉFILENT les images du film, autour de l'hôpital où tous trois séjournent, les feuilles orangées laissent place à la neige, puis à une pluie qui ruisselle sur les arbres verdoyants, à un rayon de soleil s'immisçant à travers les branchages. Les saisons se succèdent docilement et, tandis que les patients bataillent sans relâche pour parvenir à percer la carapace de leur corps et de leur cerveau rigidifiés, la nature renaît à elle-même sans effort. Ce que dit le film, c'est la lutte quotidienne de ces individus pour recommencer à être. Lutte intérieure, d'abord, pour retrouver l'usage des mots et des sons, pour parvenir à renouer le signifiant au signifié et le visage d'un proche à son nom. Christophe apprend à remettre des mots dans l'ordre pour former une phrase ; Chantal répète des phrases entières lorsqu'elle est à l'atelier de théâtre mais, chez l'orthophoniste, se montre incapable de reproduire les mots les plus simples. Lutte physique, ensuite, pour retrouver les gestes du quotidien : se lever, marcher, se diriger, enfiler un tee-shirt, tendre la main, saisir un objet, pousser une balle dans un panier. Chaque mouvement ramène le corps et l'esprit à leur infinie pesanteur.
– Prison "JE SUIS", affirme le titre. Mais les images, en réalité, interrogent la permanence de cet ancrage. Serai-je encore, lorsque mon corps me sera une prison, lorsqu'au lieu de dire "J'ai soif" je dirai "J'ai peur", lorsque je ne saurai plus prononcer le nom de mes filles ? Peut-il être question d'identité dans une machine qui, au moindre rouage brisé, menace de déformer les traits, de restreindre la parole et la pensée ? Les visages des patients de Coubert nous renvoient en miroir la fragilité de notre propre individualité, soumise aux contraintes de la mécanique corporelle. Je suis, pourtant, est un film optimiste. Non pas seulement parce qu'il se termine sur une forme de renaissance, mais aussi parce que, du début à la fin, il ne cesse d'affirmer la réalité de cette existence. Christophe, Chantal et Christophe sont, d'abord, par leur volonté d'être et par l'image d'eux-mêmes que leur renvoie leur famille. L'humiliation d’être trahi(e) par ses propres fibres est surmontée dans l'effort quotidien pour revenir au monde, dans la douleur parfois, mais aussi dans la présence aimante et émouvante des proches. En eux semble se préserver quelque chose d'une individualité qui continue à exister malgré tout, malgré la raideur des gestes et l'engourdissement du langage, au-delà des limites corporelles qui restreignent la présence à soi et au monde.
POUR CHACUN DE CES PATIENTS, la confrontation à l'image de soi est une épreuve. Christophe Gruaz n'aime pas se raser, car il lui faut pour cela scruter dans le miroir un visage qu'il ne reconnaît pas comme le sien et qui fait peur à son petit garçon. À Chantal, on montre un album contenant des photographies d'elle avant l’accident, qu'on lui demande d'identifier. "J'aime pas", répond-elle, en essayant de tourner les pages pour ne plus se voir. Devant les photos de son mari et de ses filles, au contraire, elle sourit, s'attarde, effleure les images d'un geste tendre. C'est en eux, semble-t-il, qu'elle se voit être. Et peut-être Christophe Favard, lui aussi, se voit-il en l'Autre lorsque, au cours d'un exercice dont le but est de coordonner ses gestes à ceux de la personne qu'on a en face de soi, il entend un médecin lui dire : "C'est toi qui te regardes dans le miroir." Devenu capable de toucher de sa main celle de la personne qui lui fait face, il suscite l'enthousiasme des soignants comme si, dans ce mouvement, s'était brisée une vitre entre lui-même et son image.
–
Labyrinthes
L'ŒIL DE LA CAMERA, autre miroir imaginaire, démultiplie cette question du double en y ajoutant les regards invisibles du public. Dans les inconnus qui occupent l'écran, les spectateurs peuvent à leur tour percevoir quelque chose comme un reflet d'eux-mêmes car le film, bien que documentaire, use de stratégies qui confinent à la fiction et qui favorisent l'identification. L'architecture de l’hôpital semble figurer les labyrinthes intérieurs dans lesquels chaque patient se débat quotidiennement. A plusieurs reprises, comme si elle ne savait plus comment s'orienter, la caméra s'égare, erre, vacillante, le long des couloirs vides, filme une série de radiographies du cerveau. Des éclats de voix nous parviennent, perçus comme à travers le sommeil. Dans un corridor désert, une petite télévision diffuse une émission culinaire, où l'on voit des mains agiles découper en rondelles une banane.
CES SCÈNES, FILMÉES DANS L'OMBRE et le silence, se chargent d'une dimension irréelle qui ramène l'espace à sa fonction symbolique. À la limite de l'onirisme, elles semblent adopter le point de vue imaginaire de patients devenus personnages et se confondre avec un regard qui révèle une vision intérieure plutôt qu'une perception objective du lieu. Dans l'œil de cette caméra qui arpente les allées étroites du bâtiment sans en trouver la porte de sortie, le spectateur fait l'expérience visuelle de la contrainte, de la rigidité des gestes et des perceptions. Il voit autrement des scènes qui, ailleurs, sont filmées d'un point de vue extérieur : celle où Christophe Favard se perd dans l'hôpital et ne retrouve plus le chemin de sa chambre ; celle où on lui dit d’emprunter un escalier en colimaçon et où il prend la route opposée. L'image apparaît dès l'affiche du film : une main dans laquelle est dessinée un labyrinthe et, en son centre, une maison : pour rejoindre celle-ci, il n'est pas de route directe, mais des tours et détours dans lesquels on risque de ce perdre sans jamais atteindre son but.
LA MANIÈRE DONT LE CINÉASTE met en intrigue ce cheminement participe également du processus d'identification. Emmanuel Finkiel ne se contente pas de filmer des situations disparates ou des bribes de discours. Il raconte une histoire avec un début précisément situé – le 13 novembre 2008 à Coubert – et une fin qu'il invite le spectateur à imaginer heureuse. Pour chacun des patients, le film s'achève par un changement qui est un début de résurrection, et qui répond à la tension dramatique entretenue pendant le déroulement. La musique, l'angle de certaines prises de vue et l'enchaînement des images procèdent d'une véritable mise en scène qui, parce qu'elle permet de pénétrer l'intériorité des personnes filmées, remplace la parole dont elles sont partiellement privées. L'exemple le plus frappant est celui où Christophe Gruaz, dans la salle de sport où l'on rééduque les mouvements des patients, met en route son iPod. Une musique stimulante se fait alors entendre, comparable à celle que l'on pourrait imaginer dans un film de boxe, avant que le héros ne monte sur le ring. Elle fait écho à ce que le père de Christophe dit de lui : "C'est un gagneur." Les gestes qu'effectuent les patients, si simples pour la plupart des spectateurs – mettre les pieds dans des cerceaux, avancer en s'aidant de barres latérales – sont ainsi ramenés à leur juste proportion : celle d'une victoire immense sur le corps, obtenue au prix d'une vigilance constante devant ses propres défaillances. Chantal et les deux Christophe ne peuvent plus s'exprimer, mais les images du film parlent pour eux : de leur effort, de leur douleur, de leur détresse, de leur amour des leurs et de la joie inquiète de revenir à soi-même.
F. K. ---------------------------------- à Paris, le 27/07/12 Je suis
Documentaire français de Emmanuel Finkiel
Sortie le 11 avril 2012 CET ARTICLE FAIT PARTIE DU DOSSIER "CONTRAINTES"