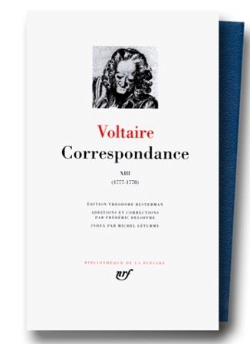 L'édition critique : mode d'emploi
L'édition critique : mode d'emploi
Quel Balzac lit-on avec Le père Goriot ? Celui de la première publication ou la version que l'auteur a ensuite remaniée pour intégrer le roman au cycle de La Comédie humaine ? Sait-on que l'édition des Lettres persanes, à laquelle on a l'habitude de se référer et qui est datée de 1721, correspond en réalité à une édition augmentée, parue en 1755 ? Comment présenter l'oeuvre complète de Marguerite Duras, bientôt publiée aux éditions La Pleïade ? Ne pas y voir de questions de spécialistes : ces nuances induisent des différences de lecture notables. Si la diffusion des écrits est aujourd'hui largement assurée, par voie imprimée ou électronique, garantir la fiabilité et la lisibilité d'un texte est une entreprise difficile : tels sont les enjeux de ce que l'on nomme l'édition critique, enjeux rendus plus importants encore par la crainte de voir les reproductions parfois fautives se substituer au texte original, d'en voir le sens s'obscurcir au fur et à mesure que l'on en perçoit moins le contexte de production.
L'évocation d'une édition critique appelle souvent l'image d'un texte noyé sous un ensemble de notes et de commentaires, perçus comme envahissants ou stériles. Pourtant, loin de se résumer à cet apparat, l'édition critique, ou savante, est nommée comme telle avant tout parce qu'elle n'est pas simple reproduction augmentée mais qu'elle représente une véritable réflexion sur le texte : sur sa création, son histoire, son sens. Au-delà de la diffusion de documents peu accessibles - brouillons, versions manuscrites ou imprimées -, elle tend à restituer une oeuvre au plus près de l'idée qu'a pu s'en faire son auteur, à retracer les étapes de sa production, à en fournir des clés de compréhension. Cela suppose, au préalable, que le texte fasse l'objet d'une recherche approfondie, que son établissement s'appuie sur des connaissances solides et interdisciplinaires - tant historiques, sociologiques que linguistiques. Cela suppose aussi et avant tout un choix : celui du texte à reproduire.
A la recherche d'un texte fiable
Diffuser un texte authentique auprès d'un vaste public, telle est la première mission que se donne l'éditeur scientifique. C'est loin cependant d'être chose facile, quand on sait que les manuscrits, véritables références pour l'établissement d'un texte mais considérés jusqu'au XIXe siècle comme des brouillons, ont souvent été détruits. Lorsqu'il existe un manuscrit autographe - de la main de l'auteur -, comme c'est souvent le cas pour les textes les plus récents, la version à reproduire est toute trouvée. Un roman comme celui d'Alain-Fournier,
Le Grand Meaulnes, par exemple, ne laisse place à aucune hésitation, puisque, publié en 1913 après une maturation de plus de huit ans, il n'a jamais été remanié après sa parution (et pour cause, l'écrivain est mort l'année suivante).
Mais si le lecteur ne connaît souvent d'un ouvrage qu'une unique version, il peut en exister plusieurs ; et, difficulté de taille, toutes n'ont pas été supervisées par l'auteur. Un écrivain prolixe comme Voltaire - ses
Œuvres complètes en Pléiade comptent plusieurs dizaines de tomes - donne bien du mal à ses éditeurs : le succès de certains de ses écrits a été tel que les impressions se sont multipliées, à une époque où les moyens de production, artisanaux, généraient quasi-systématiquement des coquilles dans le texte. Si les impressions officielles n'ont pas préservé le texte des distorsions, que dire des impressions pirates, non relues par l'auteur ? Comment dès lors distinguer les reproductions déviantes des éditions originales ? Comment déceler des erreurs qui sont parfois minimes mais peuvent changer le sens d'un passage ? L'éditeur du XXIe siècle devient alors un véritable enquêteur afin de

rassembler et de sélectionner les reproductions fiables : les manuscrits, les annotations ou la correspondance entre l'auteur et son éditeur sont autant de pièces à conviction qui permettent d'authentifier un texte et de le considérer comme légitime. L'investigation ne s'arrête pas là car, après avoir discerné les exemplaires authentiques, il faut encore les comparer et choisir celui qui, au vu de la confrontation, se révèle le plus conforme aux intentions de l'auteur ; du moins, la version la plus conforme à ses intentions supposées.
Traditionnellement, celle-ci correspond à la dernière des éditions produite du vivant de l'auteur, celle qu'il a lui-même remaniée, revue et corrigée, parfois même enrichie. Mais cet usage est contesté. Voir par exemple l'édition en cours des
Œuvres complètes de Montesquieu, dont les premiers tomes sont publiés à la Voltaire Foundation et les suivants chez Classiques Garnier et ENS Editions : ce projet, né de la volonté de fournir l'ensemble des éléments susceptibles de cerner la pensée de l'écrivain en donnant accès à des textes inédits - et notamment à une vaste correspondance - préfère rester vigilant face à ce dogme éditorial. Pour Catherine Volpilhac-Auger, Professeure de Littérature à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon et codirectrice de la publication de ces oeuvres complètes, le choix est complexe : "
Comment dire si les remaniements apportés par l'auteur à des textes fortement critiques ne sont pas des concessions faites face à la censure ?" Entre la première et la dernière édition des
Lettres persanes, onze lettres ont été ajoutées, qui enrichissent la dimension romanesque de l'ouvrage en insistant sur la vie au sérail et sur les relations entre les favorites, alors que les positions les plus critiques - sur le suicide par exemple - sont adoucies. Question épineuse, et donc polémique, que celle du choix du texte ; et ce choix, aussi justifié soit-il, "
constitue inévitablement une interprétation", précise Catherine Volpilhac-Auger. Mais ce que permet justement une édition critique, ajoute-t-elle, c'est de donner au lecteur les instruments qui lui permettent de comprendre les raisons des choix effectués.
Editer, c’est interpréter
L'étude de l'écrit et de ses variantes est une étape incontournable pour l'éditeur critique, qui doit se faire expert en manuscrits. Mais sa tâche vise moins à accumuler différentes versions qu'à élaborer un appareil critique - préface, notes, annexes - pour éclairer le texte présenté. Ainsi, les brouillons d'un texte, quand ils sont accessibles, c'est-à-dire à la fois correctement conservés et libres de droit, sont précieux, à la condition de pouvoir fournir un éclairage significatif. Selon Marie-Hélène Boblet, Maître de Conférence à l'Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle et auteur de plusieurs éditions savantes, "
l'éclairage du texte constitue l'enjeu essentiel de l'appareil critique, pensé pour offrir des outils de compréhension et des pistes d'interprétation" : "
La vocation de l'éditeur est alors de mettre son travail de recherche au service de la mise en perspective du sens, travail de patience et d'humilité puisqu'il demande parfois plusieurs années de lecture et de prise de notes." Il faut sans doute avoir sous les yeux les caisses entières de précieux manuscrits que le chercheur a à éplucher pour se représenter le travail de fourmi à l'origine de l'établissement du travail critique. Et sur les milliers de feuillets, sur l'ensemble des ratures et des réécritures, seules celles qui se révèleront signifiantes pour la compréhension du texte seront conservées.
Loin d'être uniforme, l'appareil critique peut mêler en proportions variables des éléments de compréhension, de contextualisation ou d'analyse. Selon les objectifs de l'édition et le public auquel l'ouvrage se destine, la ligne éditoriale met ainsi l'accent tantôt sur l'information, en rassemblant un certain nombre de données concrètes et en établissant des faits aptes à éclairer l'œuvre, tantôt sur le commentaire, en privilégiant des observations d'ordre interprétatif. De ces orientations découlent des approches critiques diverses, ce dont peut témoigner Marie-Hélène Boblet en vertu de deux expériences éditoriales bien différentes : celle de l'élaboration de l'édition savante du roman d'Alain-Fournier,
Le grand Meaulnes, publiée en 2009 aux éditions Honoré-Champion, et celle de la contribution à l'édition critique des
Œuvres complètes de Marguerite Duras en Pléiade.
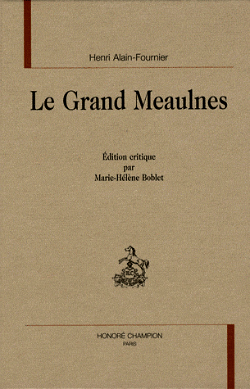
Depuis plusieurs années en effet se prépare l'édition en quatre volumes de l'intégrale de Marguerite Duras : la parution des deux premiers tomes est prévue pour octobre 2011, les deux derniers devraient paraître en 2014, année du centenaire de la naissance de l'écrivain. Il s'agit avant tout de rendre accessible l'ensemble des textes composés sur un demi-siècle par Marguerite Duras, qui entre en littérature en 1943 et écrit jusqu'à la veille de sa mort en 1996. Le lecteur curieux de connaître les différentes facettes de l'auteur de
L'Amant pourra suivre le cheminement d'une création qui explore tant le domaine du roman que celui du théâtre et du cinéma. Mais il s'agit également, pour les nombreux chercheurs appelés à collaborer à ce projet, de rassembler un ensemble d'informations qui permette d'élucider la compréhension des textes sans délivrer de commentaires et d'observations d'ordre interprétatif. En ce qui concerne par exemple la part théâtrale de l'œuvre, l'appareil critique permet de contextualiser les pièces et de comprendre leur création. Que se passe-t-il dans l'actualité, politique notamment, au moment de l'écriture des pièces ? Que se passe-t-il encore chez Marguerite Duras et qu'écrit-elle en parallèle ? Quelles ont été les différentes mises en scènes de ces pièces et que peut-on dire de leur réception médiatique et critique ?
Les éditions Honoré-Champion, avec l'édition critique du roman
Le Grand Meaulnes, ont plutôt privilégié un travail d'interprétation : préfaces, notes et annexes cherchent tant à expliquer le texte qu'à en proposer une analyse. Une part de l'appareil critique retrace la genèse de l'oeuvre - des extraits de la correspondance de l'auteur, ainsi que de
Miracle, texte considéré comme un laboratoire du roman, sont reproduits en annexe ; une autre part souligne l'évolution de la réception médiatique, de l'accueil fait au roman à sa parution en 1913 à la récupération nationaliste qui s'opère en 1944. Le travail d'interprétation, fondé sur une étude grammaticale, lexicale et stylistique, tient quant à lui une place importante dans l'élaboration de la préface et des notes. "
Le roman d'Alain-Fournier, explique Marie-Hélène Boblet,
avait pu être interprété comme une continuation de l'esthétique symboliste et en cela comme une oeuvre ancrée dans le XIXe siècle. Le parti pris de cette édition est de montrer que bien loin de n'être qu'un simple héritage du siècle précédent, ce roman poétique, par l'esprit d'aventure et l'aspiration au mystère qui le caractérisent, ouvre des voies nouvelles que prolonge le XXe siècle."
Philologie et technologies
L'édition critique s'est développée parallèlement à l'expansion du livre et est ainsi étroitement associée à une culture de l'écrit. Si ses visées n'ont pas tellement changé depuis l'époque où des érudits s'attachaient à copier et à commenter des manuscrits, ses techniques, elles, se sont transformées : tirant profit des évolutions dans le domaine de la diffusion de l'écrit, l'antique philologie s'approprie aujourd'hui les nouvelles technologies. Après le support papier, voici venu le temps du support électronique ? Selon le groupe de recherche "Philectre", la "philologie électronique" est bien l'avenir de l'édition critique. Beaucoup s'interrogent encore sur les vertus d'un tel changement, alors que les premières éditions critiques numériques voient actuellement le jour.
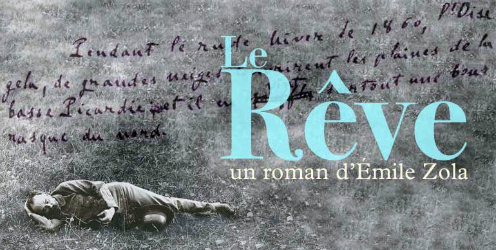
D'un point de vue pratique, l'informatique apparaît comme un outil idéal : comment représenter sous format papier la multiplication des versions d'un même texte - des brouillons aux imprimés - mais aussi le foisonnement des notes, la profusion des ratures et des réécritures ? Les nouvelles technologies offrent un ensemble d'outils qui permettent de donner tant à voir qu'à manipuler les textes. Il n'est pas étonnant que les éditeurs scientifiques se soient rapidement emparés de ces outils : Andrew Oliver, spécialiste de Balzac et directeur des Etudes Supérieures à l'Université de Toronto, publie par exemple aux Editions de l'Originale les romans de
La Comédie humaine accompagnés de cédéroms hypermédias comprenant un vaste appareil critique : brouillons, manuscrits, édition originale et éditions remaniées, documents iconographiques ou sonores permettent une véritable mise en scène du texte choisi. Et l'oeuvre de Balzac n'est pas isolée : Emile Zola (1), Gustave Flaubert (2) ou encore James Joyce (3) mettent eux aussi un pied dans l'ère numérique. Il est difficile de dire si cette évolution pourra faire basculer l'édition critique du côté du format électronique. Ce que confirme indéniablement cette mutation, c'est une volonté de mettre en valeur la diversité des textes, d'insister sur un processus de production et sur différentes formes de réception. Elle ne doit pas faire oublier cependant à quel point la visée de l'ensemble doit demeurer critique, privilégier la sélection sur la compilation, l'explication sur la présentation, et laisser au lecteur la possibilité de naviguer librement entre le texte et son commentaire.
sur Gallica, élaborée sous la direction de Philippe Hamon et de Jean-Pierre Leduc-Adine
(3) H. W. Gabler, "Vers une édition électronique de l'
, 2000, vol 15, n°1, pp. 115-120
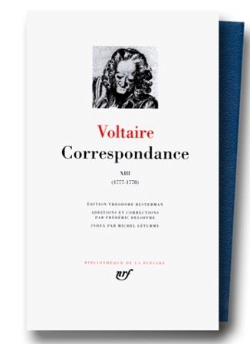 L'édition critique : mode d'emploi
L'édition critique : mode d'emploi  rassembler et de sélectionner les reproductions fiables : les manuscrits, les annotations ou la correspondance entre l'auteur et son éditeur sont autant de pièces à conviction qui permettent d'authentifier un texte et de le considérer comme légitime. L'investigation ne s'arrête pas là car, après avoir discerné les exemplaires authentiques, il faut encore les comparer et choisir celui qui, au vu de la confrontation, se révèle le plus conforme aux intentions de l'auteur ; du moins, la version la plus conforme à ses intentions supposées.
rassembler et de sélectionner les reproductions fiables : les manuscrits, les annotations ou la correspondance entre l'auteur et son éditeur sont autant de pièces à conviction qui permettent d'authentifier un texte et de le considérer comme légitime. L'investigation ne s'arrête pas là car, après avoir discerné les exemplaires authentiques, il faut encore les comparer et choisir celui qui, au vu de la confrontation, se révèle le plus conforme aux intentions de l'auteur ; du moins, la version la plus conforme à ses intentions supposées. 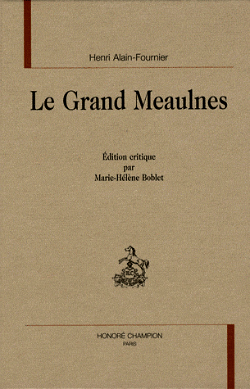 Depuis plusieurs années en effet se prépare l'édition en quatre volumes de l'intégrale de Marguerite Duras : la parution des deux premiers tomes est prévue pour octobre 2011, les deux derniers devraient paraître en 2014, année du centenaire de la naissance de l'écrivain. Il s'agit avant tout de rendre accessible l'ensemble des textes composés sur un demi-siècle par Marguerite Duras, qui entre en littérature en 1943 et écrit jusqu'à la veille de sa mort en 1996. Le lecteur curieux de connaître les différentes facettes de l'auteur de L'Amant pourra suivre le cheminement d'une création qui explore tant le domaine du roman que celui du théâtre et du cinéma. Mais il s'agit également, pour les nombreux chercheurs appelés à collaborer à ce projet, de rassembler un ensemble d'informations qui permette d'élucider la compréhension des textes sans délivrer de commentaires et d'observations d'ordre interprétatif. En ce qui concerne par exemple la part théâtrale de l'œuvre, l'appareil critique permet de contextualiser les pièces et de comprendre leur création. Que se passe-t-il dans l'actualité, politique notamment, au moment de l'écriture des pièces ? Que se passe-t-il encore chez Marguerite Duras et qu'écrit-elle en parallèle ? Quelles ont été les différentes mises en scènes de ces pièces et que peut-on dire de leur réception médiatique et critique ?
Depuis plusieurs années en effet se prépare l'édition en quatre volumes de l'intégrale de Marguerite Duras : la parution des deux premiers tomes est prévue pour octobre 2011, les deux derniers devraient paraître en 2014, année du centenaire de la naissance de l'écrivain. Il s'agit avant tout de rendre accessible l'ensemble des textes composés sur un demi-siècle par Marguerite Duras, qui entre en littérature en 1943 et écrit jusqu'à la veille de sa mort en 1996. Le lecteur curieux de connaître les différentes facettes de l'auteur de L'Amant pourra suivre le cheminement d'une création qui explore tant le domaine du roman que celui du théâtre et du cinéma. Mais il s'agit également, pour les nombreux chercheurs appelés à collaborer à ce projet, de rassembler un ensemble d'informations qui permette d'élucider la compréhension des textes sans délivrer de commentaires et d'observations d'ordre interprétatif. En ce qui concerne par exemple la part théâtrale de l'œuvre, l'appareil critique permet de contextualiser les pièces et de comprendre leur création. Que se passe-t-il dans l'actualité, politique notamment, au moment de l'écriture des pièces ? Que se passe-t-il encore chez Marguerite Duras et qu'écrit-elle en parallèle ? Quelles ont été les différentes mises en scènes de ces pièces et que peut-on dire de leur réception médiatique et critique ?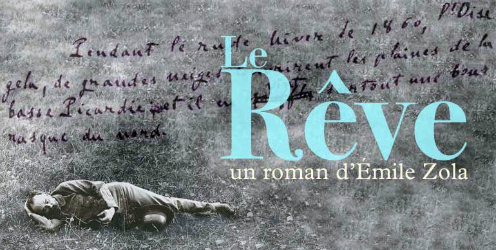 D'un point de vue pratique, l'informatique apparaît comme un outil idéal : comment représenter sous format papier la multiplication des versions d'un même texte - des brouillons aux imprimés - mais aussi le foisonnement des notes, la profusion des ratures et des réécritures ? Les nouvelles technologies offrent un ensemble d'outils qui permettent de donner tant à voir qu'à manipuler les textes. Il n'est pas étonnant que les éditeurs scientifiques se soient rapidement emparés de ces outils : Andrew Oliver, spécialiste de Balzac et directeur des Etudes Supérieures à l'Université de Toronto, publie par exemple aux Editions de l'Originale les romans de La Comédie humaine accompagnés de cédéroms hypermédias comprenant un vaste appareil critique : brouillons, manuscrits, édition originale et éditions remaniées, documents iconographiques ou sonores permettent une véritable mise en scène du texte choisi. Et l'oeuvre de Balzac n'est pas isolée : Emile Zola (1), Gustave Flaubert (2) ou encore James Joyce (3) mettent eux aussi un pied dans l'ère numérique. Il est difficile de dire si cette évolution pourra faire basculer l'édition critique du côté du format électronique. Ce que confirme indéniablement cette mutation, c'est une volonté de mettre en valeur la diversité des textes, d'insister sur un processus de production et sur différentes formes de réception. Elle ne doit pas faire oublier cependant à quel point la visée de l'ensemble doit demeurer critique, privilégier la sélection sur la compilation, l'explication sur la présentation, et laisser au lecteur la possibilité de naviguer librement entre le texte et son commentaire.
D'un point de vue pratique, l'informatique apparaît comme un outil idéal : comment représenter sous format papier la multiplication des versions d'un même texte - des brouillons aux imprimés - mais aussi le foisonnement des notes, la profusion des ratures et des réécritures ? Les nouvelles technologies offrent un ensemble d'outils qui permettent de donner tant à voir qu'à manipuler les textes. Il n'est pas étonnant que les éditeurs scientifiques se soient rapidement emparés de ces outils : Andrew Oliver, spécialiste de Balzac et directeur des Etudes Supérieures à l'Université de Toronto, publie par exemple aux Editions de l'Originale les romans de La Comédie humaine accompagnés de cédéroms hypermédias comprenant un vaste appareil critique : brouillons, manuscrits, édition originale et éditions remaniées, documents iconographiques ou sonores permettent une véritable mise en scène du texte choisi. Et l'oeuvre de Balzac n'est pas isolée : Emile Zola (1), Gustave Flaubert (2) ou encore James Joyce (3) mettent eux aussi un pied dans l'ère numérique. Il est difficile de dire si cette évolution pourra faire basculer l'édition critique du côté du format électronique. Ce que confirme indéniablement cette mutation, c'est une volonté de mettre en valeur la diversité des textes, d'insister sur un processus de production et sur différentes formes de réception. Elle ne doit pas faire oublier cependant à quel point la visée de l'ensemble doit demeurer critique, privilégier la sélection sur la compilation, l'explication sur la présentation, et laisser au lecteur la possibilité de naviguer librement entre le texte et son commentaire.